Notre esprit trouve rarement du répit, et la crise actuelle du coronavirus est là pour nous rappeler que le confinement dans un espace clos n’est pas une tâche facile pour tout le monde. Mais je vais vous dire quelque chose, de façon très personnelle, c’est normal. Ça va. C’est tout à fait compréhensible, parce que ça touche à ce qu’il y a de plus insolvable dans l’esprit humain.
Rappelez-vous, la théorie du paradoxe sensorimoteur : les structures cognitives de notre esprit tireraient leur origine d’une situation de blocage, de suspension, de retard des réponses sensorimotrices, au départ par le simple fait de regarder sa propre main et de rester fixé-e dessus (pour rappel, le blocage aurait lieu parce que ma main, pour être perçue comme un objet extérieur à moi-même, m’oblige à rester figer pour la regarder). C’est très important parce que ça pourrait marquer le début de la conscience de soi et des capacités propres à l’imaginaire humain. Je perçois l’action possible mais soudain irréalisable comme une idée en soi, accompagnée par tout un tas d’émotions dont je ne sais pas quoi faire.
Ce qui veut dire : la pensée s’appuie là-dessus pour s’élaborer, convertir la mémoire d’expériences en idées, en signes, en mots auxquels nous convions les autres et nous voyons convié-e-s nous-même par elles et eux. Mais ce qui est important, c’est qu’un mot, une pensée, une idée est là pour saisir quelque chose à la place du corps. Si vous restez immobile dans une pièce, c’est sans doute parce que vous ne vous autorisez pas à faire plus, peut-être par peur du jugement d’autrui, par l’intégration précoce et progressive des règles de conduite qui régulent notre vie parmi les autres. Mais votre corps, lui, est toujours désespéré de se saisir de quelque chose à faire. Et parfois, la pensée ne trouve pas les relais pour se saisir de plus de choses qu’elle ne le peut, se retrouve bloquée elle-même, et alors c’est le corps qui encaisse – parce que notre corps est toujours bloqué.
L’esprit humain doit constamment travailler pour maintenir cet écart, cette évaluation et ce retard constant des réponses du corps dans le but de maintenir active une conduite codifiée, obéissant à certaines règles. Lorsque nous perdons les relais sur lesquels notre esprit était habitué à travailler, une rupture s’opère parce qu’il faut, ne serait-ce que par la pensée, donner l’impression au corps de se saisir de quelque chose, relâcher la tension due son travail et la résoudre, ne serait-ce que par une stimulation imaginaire. Mais tant que nous restons à notre place, celle qui nous est assignée socialement, et nous voyons contraint-e-s de laisser notre corps se figer dans l’incertitude et l’indétermination, tant que le corps ni la pensée ne prennent le relais de cet état de perte dans lequel nous nous trouvons, alors nous faisons tout simplement face à l’élément le plus inaliénable et le plus insolvable de l’esprit humain, des structures cognitives de notre espèce : le paradoxe sensorimoteur lui-même. C’est une chance, parce que c’est un révélateur de ce que nous sommes, ce qui veut dire que c’est entre nos mains.
Les structures de la pensée humaine sont nées parce que dans une certaine situation, tout à fait particulière et liée à la libération motrice des mains dans la station debout, le corps se trouvait incapable de se saisir de ce qui stimulait son attention. La pensée humaine se fonde sur l’impossibilité de se saisir de la chose-même (en l’occurrence, sa propre main par et pour elle-même), pour se rabattre sur l’idée que l’individu-e se fait de sa propre situation. Il est donc normal de s’angoisser lorsque la pensée ne trouve plus de relais en soi et autour de soi pour se sortir de ce sentiment de blocage. C’est TOTALEMENT humain.
Mon conseil, si cela peut aider, c’est regardez les objets que vous avez autour de vous, ceux dont vous vous servez, ceux qui vous encombrent, ceux que vous n’osez pas prendre. Commencez par des petites choses. C’est bête, mais la façon dont une pièce, et notamment une chambre est organisée en dit beaucoup sur notre rapport à l’autorité, celle qui nous subjugue ou celle que nous voulons représenter. Par exemple, moi j’ai un foutoir de livres autour de moi, notamment, et c’est normal, parce que ça fait diversion de ma peur de l’autorité. C’est une manière de laisser s’accumuler une sorte de jungle totalement autonome d’objets possibles à l’intérieur de laquelle je me dissimule. Alors en ce moment, je m’astreins à réorganiser ma bibliothèque en fonction de mes besoins, qui sont légitimes. C’est un exemple, mais ça veut dire surtout : (re)créer les relais qui vous manquent, qui vous bloquent dans votre pensée, dans ce que vous ne vous autorisez peut-être pas à être.
Et surtout rappelez-vous : nous sommes des êtres humains, et notre nature repose sur un handicap (ce qui est quand-même fou si on y regarde de plus près). Personne n’est parfait ni absolu, mais nous avons tou-te-s la chance et l’opportunité de trouver l’harmonie en nous-même, avec du travail et de l’indulgence, et surtout, beaucoup, beaucoup d’amour.
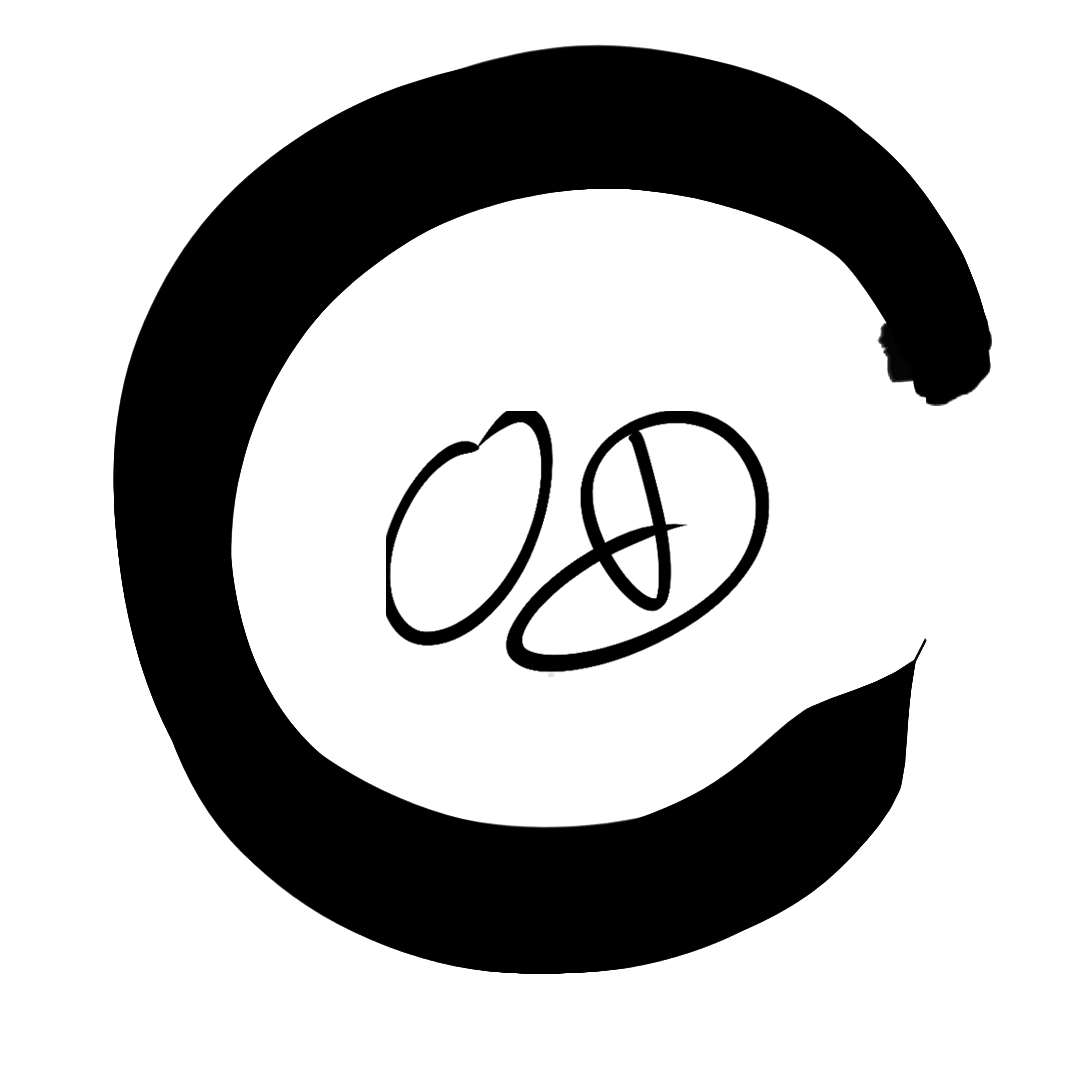

Laisser un commentaire