On l’a vu, l’esprit humain fait un certain usage de la mémoire que le corps engrange et mobilise en permanence. La perception que nous avons de nos environnements directs est cerclée d’une certaine prévention vis-à-vis de la possible résurgence d’événements traumatiques, certains rencontrés dès le plus jeune âge. La place symbolique accordée à ce qui est le plus proche de nous a souvent valeur de protection et notamment, nous apprenons de façon précoce à nous entourer d’objets identifiés comme étant les nôtres, ne serait-ce que symboliquement, comme une extension du domaine de plain droit que nous détenons sur notre propre corps – hypothétiquement.
Nous apprenons ainsi très tôt à faire usage de la place de ces éléments symboliques en lieu et place de l’expression directe de nos impulsions à interagir avec les espaces au-delà. « Tu ne peux pas jouer avec tel ou tel objet qui appartient aux adultes, mais tu le peux avec ceux-ci qui sont tes jouets. » « Ne me demande pas de jouer avec toi, mais va plutôt jouer avec ta sœur ou ton frère, ou avec tes jouets, ou dehors. » Nous apprenons donc à utiliser ces éléments symboliques d’interaction en lieu et place de tout autre. Nous n’avons pas le droit d’employer certains objets et espaces qui nous sont interdits mais aussi, nous sommes enjoint-e-s d’en adopter certains autres, avec les conduites associées qu’il s’agit d’apprendre lors de notre socialisation.
De même, dans l’élaboration du trauma et ce dès les premiers contacts d’intensité avec l’extérieur, nous apprenons à substituer à la chose même à l’origine de la marque sensorielle ou émotionnelle, voire de la blessure, l’expression de notre détresse (en premier lieu une détresse liée à l’indétermination sensorimotrice) dirigée vers une autre chose. Ce que le psychanalyste anglais Donald Winnicott appelait l’aire intermédiaire entre l’objet primaire et la conscience de soi, notamment via les objets transitionnels tels que les doudous chez les tout-petits, peut bien constituer un modèle pertinent à la fois de l’élaboration de la relation à l’objet et du champ symbolique.
Nous élaborons le trauma, la substitution du récit imaginaire à la relation à la chose-même qui fut à l’origine de la blessure, en usant de cette capacité à élaborer cet espace, ce qu’il y a entre l’impulsion à exprimer directement mon souhait ou ma détresse et l’impossibilité de le faire. Ce qu’il y a entre les deux, c’est n’importe quoi qui peut se trouver entre mes mains, soit qu’on ne me laisse que ça, soit qu’il n’y ait en effet rien d’autre.
Progressivement, nous ne prenons même plus la peine d’essayer de passer par la voie directe et nous dirigeons immédiatement vers les voies substitutives : nous employons le champ symbolique pour lui-même, qui prend une part autonome dans notre vie psychique et occulte les raisons initiales de son emploi. Une fois sédimenté en une conduite socialement identifiable, contrôlable et intégrée, le champ symbolique capte tellement d’enjeux dans la relation de l’individu-e aux autres qu’il peut devenir très difficile d’en remonter à la source, surtout lorsque le niveau de complexité de ces enjeux – qui sont des enjeux de dette morale – croît.
Comment dès lors interpréter cette conduite, à la fois pour le ou la patient-e et pour l’analyste ? Quelle est la position de l’analyste et de l’analyse par rapport à celui- ou celle-ci ? Comment élaborer une herméneutique et une phénoménologie utile aux deux, et quels espaces forment-ils/elles ?
Champ symbolique et projection
Tout d’abord, il est important de noter que tout individu-e projette des enjeux vitaux à l’intérieur de tout ce qui lui passe entre les mains, de manière consciente ou non. Le flux de pensée lui-même est un signe de ce que le corps se maintient dans une activité de façon à « rester en vie », en éveil. Il y a une tension téléonomique au cœur de cette activité qui fait que le corps tente de donner une fonction et une raison, au sens mathématique d’une raison agissante, à la moindre de ses situations dans l’espace et le temps où il est présent à ses environnements d’interaction.
La réalité perçue par l’individu-e est toujours une image, ici aussi au sens mathématique, qui est une fonction et une application interactive de ses propensions sensorimotrices. Je perçois mon environnement direct comme une enveloppe, coordonnée par ma manière de me projeter dans l’espace et le temps en terme de mouvement. Ma perception propre (il faut se souvenir que l’étude phénoménologique de la perception du temps remonte au moins jusqu’à la distentio animi de Saint Augustin) y est conditionnée. La situation de paradoxe sensorimoteur réduit par ailleurs ce mouvement jusqu’au terme de strict potentiel, lequel est imaginaire, c’est-à-dire qu’il est une image de cette impulsion à faire, une projection en attente d’actualisation. Je prends l’image en lieu et place de la chose même – premier trauma fondateur de notre condition en tant qu’espèce. De même, ce conditionnement par le mouvement intervient dans sa limitation à l’intérieur du champ social, notamment de par l’apprentissage précoce des règles morales au sein de la structure familiale ou substitut, que ce soit de manière explicite par l’apprentissage des règles de conduite ou implicite par apprentissage mimétique.
Aussi, qu’importe la configuration de cette structure, elle impose sa marque à l’élaboration de l’identité de la personne, qui voit ses modalités d’expression façonnées, faites relatives aux espaces d’interaction qu’elle propose. L’analys-t-e ne doit pas présupposer de la typologie de cette structure, si ce n’est du contexte globale dans lequel elle émerge. Mais ici encore, le caractère définitif de ce contexte ne peut être supposé, du seul fait qu’il est contingent à une évolution particulière et à la singularité de sa genèse. Par exemple, la systématisation des sociétés capitalistes et patriarcales n’avait pas tout lieu d’exister ; seulement il se trouve que cette possibilité a été énactée par l’histoire. Nous ne pouvons observer cette dernière que de façon rétroactive.
Pour reprendre les idées liées à l’herméneutique développées par le philosophe Français Paul Ricœur dans Temps et récit (1983), le temps du récit suppose sa conception formelle et sa ritualisation : nous écoutons, lisons ou assistons à une histoire en présupposant sa situation globale dans le temps quotidien, à savoir que le récit commence et aboutira à une fin, suivant certaines péripéties. Nous apprenons de manière précoce à suivre le fil d’une histoire et nous nous attendons à ce que celles qui viendront dans le futur obéissent à certaines règles similaires, lesquelles conditionneront la perception que nous avons du rythme, du style et de l’intensité de leur déroulement. Le sens esthétique suppose ainsi la circonscription dans le temps et dans l’espace d’une certaine situation et d’un certain rapport à l’objet pour lequel nous nous mettons en état de disponibilité. De même, notre propre situation dans l’espace et le temps social ainsi que la narration que nous développons sur nous-même supposent que nous connaissons la forme biographique par laquelle l’histoire de la vie d’autres personnes est généralement racontée. Nous appréhendons ainsi la valeur que peut prendre notre vie dans l’histoire collective et la rendre palpable, susceptible d’être appréhendée dans sa globalité et intelligible.
Cette prise de sujet au creux et à la convergence de plusieurs niveaux d’interaction symbolique, sociale et morale (la sphère intime, la sphère familiale, la sphère sociale et la sphère globale) donne la complexité des voies par lesquelles celui- ou celle-ci accède à ses propres motivations. Le sujet se perçoit comme agent-e de sa propre narration, laquelle répond à des règles apprises à travers les structures du récit. L’ordre qu’on suppose du vivant, à travers le prisme de nos sociétés actuelles, n’est que le résultat d’une topologie sociale qui canalise les voies et les modalités d’interaction des individu-e-s avec leurs divers environnements, et s’inscrit tout autant dans les canons narratifs des cultures considérées. Le symbolique de la narration imprègne et se fait le vecteur de l’agentivité sociale de l’individu-e.
De même, la relation du sujet à la personne de l’analyste elle-même, lorsqu’elle a lieu, soumet les conditions du discours de l’individu-e sur lui- ou elle-même à un ensemble de contraintes propre à la relation singulière entre ces deux personnes, au sein du modèle sociale où se déroule l’analyse. Il y a un effet de concentration, dans cette même pièce, de toutes ces contradictions qui tordent le champ de la narration, puisqu’il faudrait tout dire alors même que toute personne est en prise avec un environnement social contraignant, avec son histoire individuelle et collective. Le temps du récit collectif heurte le temps de la narration individuelle.
Le travail sur les conditions du discours, la réflexion sur la nature-même de ces réseaux de contrainte constitue le cœur de l’analyse. Elle doit se dérouler dans l’espace intermédiaire et neutre entre le ou la patient-e et l’analyste, celui-là où peuvent s’élaborer des conditions nouvelles pour que ce discours puisse se réinventer. La figure de l’analyste doit donc faire office de « contre-exemple » vis-à-vis du symbolique, mais aussi vis-à-vis des modalités du discours, notamment en admettant les ruptures et les discontinuités.
Il ne s’agit pas de prendre la figure de l’analyste en lieu et place d’autre chose, mais de prendre l’espace entre les deux pour lui-même (pour reprendre les mots du psychanalyste Français Dominique Assor lors d’une rencontre du Cardo à Toulouse, un espace similaire à celui de l’improvisation musicale1) : l’espace où s’élabore la relation à l’objet et au champ symbolique de manière délibérée. C’est là que l’analyste doit toujours s’efforcer de guider la personne, même lorsque celle-ci tenterait de se saisir d’autre chose.
Ce travail ne peut être que progressif, car il faut d’abord identifier ce qui interdit à la personne de s’en saisir de plain droit, de façon complètement légitime. Or cet espace est virtuel et n’appartient à personne, il est libre de dette et c’est pour ça que quiconque peut l’investir et l’élaborer de façon singulière et située.
Effet miroir
Le plus difficile est d’établir la concordance entre l’usage et l’investissement du champ symbolique par l’individu-e dans son apprentissage social, et les raisons intimes de l’élaboration du trauma qu’il ou elle peut avoir toutes les difficultés du monde à identifier, souvent parce que les voies d’accès et d’expression de ces raisons ont été inhibées voire proscrites. Cette proscription et cette inhibition sont à l’œuvre constamment dans la tentative du sujet de maintenir pour lui- ou elle-même un environnement mental conforme à la morale apprise, de façon soutenue dans l’activité de son flux de pensée. La résistance à abandonner cet engagement vital dans l’effort de représentation des conditions-même par lesquelles l’individu-e se projette dans ses divers environnements et en perçoit la globalité, il faut comprendre qu’elle est vitale parce qu’il y a une menace à l’origine. Cette résistance est élaborée par le trauma, lequel recouvre bien souvent complètement la mémoire d’un (ensemble d’)événement(s) perçu de façon intensément sensorielle. La répression traumatique est à la base de la théorie psychanalytique telle qu’élaborée par Sigmund Freud à son origine, puis à travers le terme de forclusion, qui signale la part active du langage (encore une fois, pouvant être étendu à tout type de langage) dans le refoulement.
Il en va de la survie morale du sujet – dans la dimension de la dette contractée vis-à-vis de la figure faisant l’autorité et de l’obéissance du sujet à son devoir de soumission. La psychanalyste Suisse Alice Miller l’analysait sous l’angle du commandement à honorer son père et sa mère, mais on peut l’étendre de manière plus générale et structurelle au-delà de la cellule familiale traditionnelle. Par ailleurs, nous apprenons autant qui nous sommes pour les autres, pour ce qui nous entoure, d’une feuille qui tombe d’un arbre et touche notre main que d’un père qui nous sermonne d’avoir excédé telle ou telle limite établie par l’ordre familial et social ; c’est pourquoi la définition du trauma ne varie que par degré d’intensité. L’enjeu dépendra de la demande initiale du sujet qui se la voit refusée. Fatalement, la demande vis-à-vis d’un-e parent-e dont on espère une réponse – notamment et surtout affective – concentrera un impact plus fort en cas d’opposition qu’une autre moins soumise à des relations de dépendance.
Il y a une dérivée de ça dans le stade du miroir, de la manière dont l’élabora le psychanalyste Français Jacques Lacan, et ce qu’il se formule de manière littérale à l’endroit d’un miroir réel ou de situations sociales similaires (par exemple, dans certains rituels où une personne est habillée et/ou maquillée par d’autres, ou dans les interactions précoces entre un nourrisson et sa mère ou substitut, comme le suggérait la chercheuse en neuroesthétique Américaine Ellen Dissanayake). Ici, la demande d’attention peut être adressée de manière indirecte. Lorsque l’autre observe avec nous notre reflet dans le miroir (ou notre représentation à l’image de certaines règles socio-esthétiques), il ou elle nous accorde de l’attention dans la mesure où nous sommes pris-e dans une situation particulière où je suis représenté-e par ma propre image, laquelle renvoie l’occasion d’un discours. J’apprends alors que l’image que je renvoie a une importance et qu’elle est toujours captée dans un réseau d’influence par mes pair-e-s. J’apprends en fait à surveiller cette image et à exercer un contrôle dessus, autant que possible.
Le flux de pensée, autant que le contrôle sur ma propre conduite, se situe dans cette zone où je reste fixé-e sur cette image, à la limite de ce qui m’est visible et invisible de moi-même – l’endroit du paradoxe. Je sais que les autres vont déterminer quelque chose de moi à partir de ce qu’ils ou elles voient ; mais je sais aussi que cette image peut ne pas concorder avec ce que je vis intérieurement et qui est inaccessible, pour une part, à l’œil externe. Comme le suggérait Winnicott, on apprend à être seul-e en présence de quelqu’un d’autre justement en s’informant de ce que l’autre voit ou ne voit pas. L’autre n’est pas omniscient, et pourtant nous ne savons pas jusqu’à quel point. À quel point l’autre prend part à l’élaboration de cette voix intérieure qui constitue mon flux de pensée ? Mes perceptions imaginaires ? Réelles ?
Le travail sur la psychose effectué par le psychanalyste Anglais Darian Leader (Qu’est-ce que la folie ?, 2011) nous renseigne bien justement sur la difficulté de l’individu-e psychotique à déterminer ce qui vient de l’intérieur ou de l’extérieur dans l’interprétation qu’il ou elle fait de ses pensées et de ses perceptions sensorielles. Le plus important dans tout ça, c’est que l’individu-e soit concerné-e par ce qui lui arrive, qu’il ou elle ne soit pas, d’une certaine manière, poussé-e à être lui- ou elle-même extérieur-e à sa propre vie, désincarné-e, que la narration de sa propre histoire ne lui appartienne plus, qu’il ou elle en soit dépossédé-e de façon radicale : de l’intérieur. Au-delà de la psychose, ce sentiment peut rejoindre celui de toutes les personnes issues de minorités politiquement et civiquement invisibilisées par l’histoire, subalternes, privées de l’exercice entier du droit.
Je terminerai ce cycle en rappelant qu’il n’y a pas de souffrance sans pressurisation des individu-e-s, de quelque forme que ce soit. Un contact, le plus subtil soit-il, implique aussitôt sa perte, laisse une marque, provoque une transformation. C’est l’activité du trauma, de transformer la perte d’un contact, quelle que soit son intensité, en une nouvelle unité, en une raison sur laquelle on ait un contrôle, un substitut de survie. On ne peut travailler sur le trauma sans travailler sur les conditions qui l’ont produit, et souvent elles s’élaborent et se répercutent sur plusieurs échelles, avec une multiplicité de points de vue.
Il faut aussi admettre que la psychanalyse soit limitée. Mais c’est avec cette limite qu’on travaille, et c’est au-delà d’elle que la personne élabore les conditions de sa liberté. Nous espérons, par notre travail, y contribuer d’une manière ou d’une autre.
1« Mais ce qui me semble important d’articuler ici c’est que le moment d’improvisation est précisément le moment où le musicien ne pense pas, ce qui rend d’ailleurs singulier son art. […] Autrement dit, et pour reprendre mon propos, nous ne pouvons faire autrement que de remettre sur le tapis à chaque instant l’institution, toujours langagière, cet ordre, ce point de départ, cette cause, cette condition d’une parole et du malentendu. […] Un bon chorus de jazz laisse l’auditeur devant une impossibilité de savoir ce qu’il faut entendre, entièrement libre. Contrairement au discours universitaire qui produit de l’élève, et il en faut, au discours du maître qui produit un travailleur, et il en faut aussi, il y a dans l’œuvre un lien au Discours de l’analyste en tant qu’elle promeut un trou, en fait l’agent du discours, laissant le sujet devant la nécessité d’interpréter, de créer son propre « phrasé », soit de créer à son tour les signifiants qui vont le représenter et dans le meilleur des cas : d’en répondre. […] Pour conclure, être jazz serait de concéder à sa propre institutionnalisation et s’en servir pour y loger sa voix singulière. S’institutionnaliser suffisamment, soit mettre les deux pieds dans l’ordre en marche et de l’intérieur le creuser, se creuser. Dig it ! » Dominique Assor, « Le risque est de s’institutionnaliser », 2019.
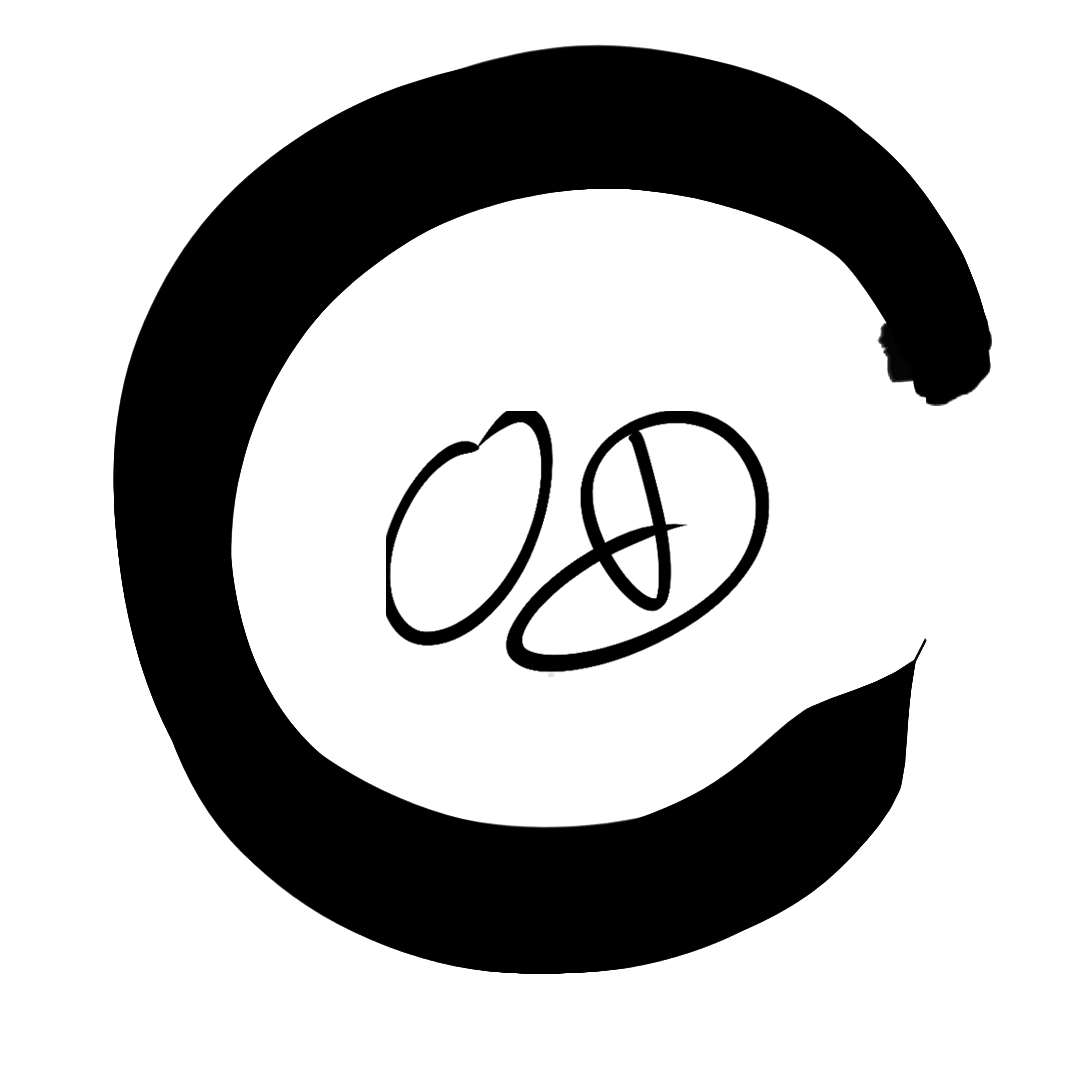
Laisser un commentaire